Territoires étudiés
La Réunion – Maurice – Rodrigues – Mayotte
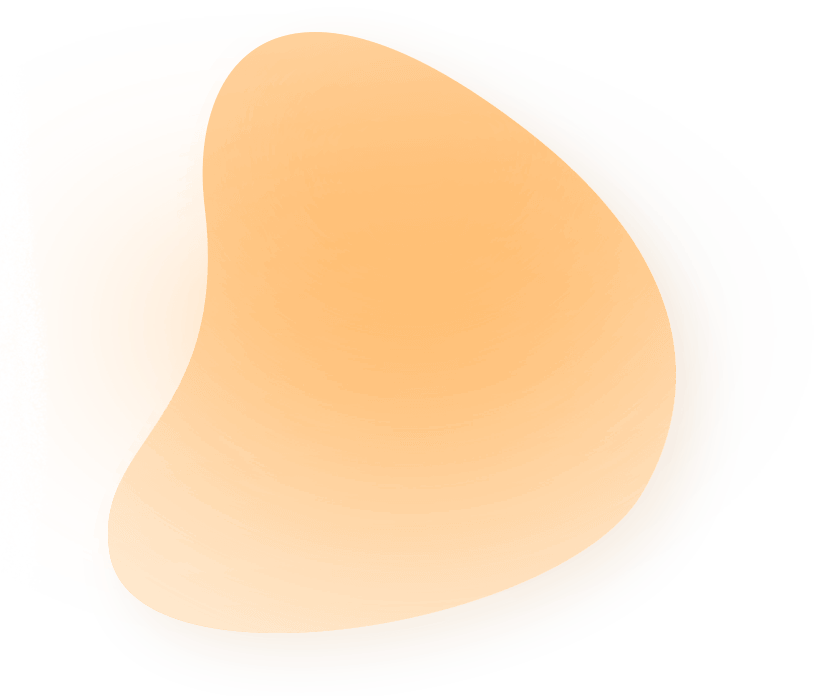
DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ALIMENTATION
À La Réunion
L’alimentation à La Réunion reflète les métissages qui ont façonné la société réunionnaise en contexte colonial et post-colonial.
Initialement influencée par les populations malgaches et indiennes, la société réunionnaise a rapidement évolué, marquée par le système de plantation et l’arrivée d’esclaves originaires principalement de Madagascar, d’Afrique et d’Inde, puis après l’abolition de l’esclavage en 1848, à travers différentes vagues migratoires, celle de populations engagées provenant d’Afrique, d’Asie et d’Europe. L’île a intégré ces diverses influences dans ses pratiques alimentaires.
Aujourd’hui, les systèmes alimentaires réunionnais connaissent une transition rapide, influencée par la mondialisation et l’évolution des modes de consommation.
Le projet OR-ALIM préfigure la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des transitions alimentaires. Il permettra d’identifier les leviers et les freins à la mise en place de systèmes alimentaires plus durables, tant au niveau de la consommation que de la production, en faveur d’une alimentation plus responsable et plus ancrée géographiquement et culturellement.
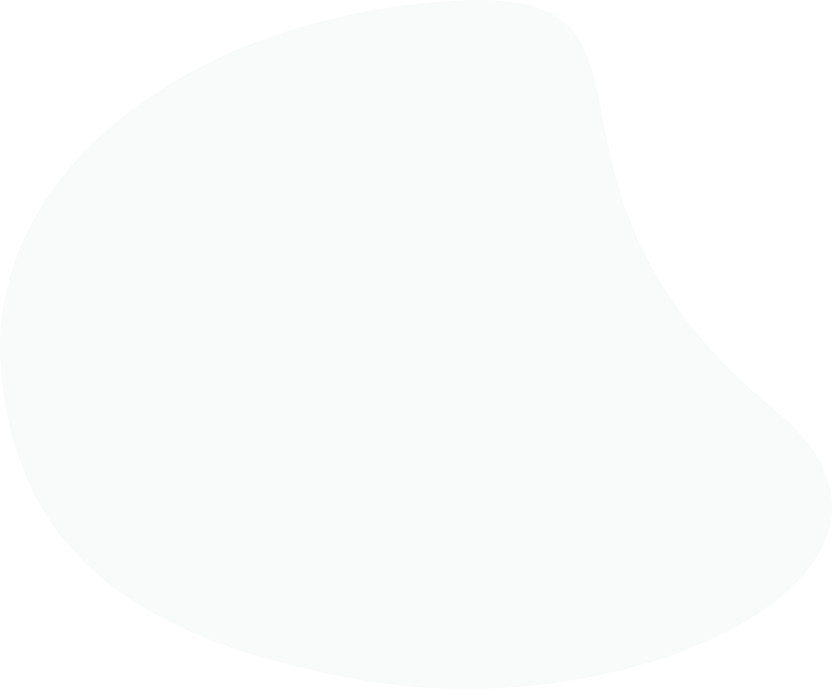


Traditions culinaires
À La Réunion, les traditions culinaires se caractérisent par une coexistence entre des recettes et manières de manger locales influencées par la créolisation et des modèles extérieurs.
Les plats traditionnels sont toujours présents dans les habitudes et en même temps, la consommation de produits nouveaux et souvent, “mondialisés”, augmente.
Cette cohabitation traduit les dynamiques de transformation à l’œuvre.


Santé publique
À La Réunion, l’émergence de pathologies telles que l’obésité, l’hypertension artérielle et le diabète est de plus en plus préoccupante. Ces maladies, souvent liées à une alimentation déséquilibrée, résultent de mutations dans l’alimentation et d'une sédentarité croissante.
Ce phénomène souligne l'importance d’adopter des habitudes alimentaires plus saines et de sensibiliser la population aux enjeux de la nutrition pour améliorer la santé publique.
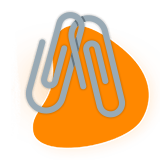
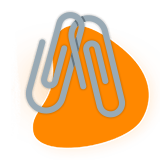
Dépendance
À La Réunion, plus de 80 % des produits alimentaires sont importés, ce qui entraîne une forte dépendance. L’économie locale, dépendante des transferts publics nationaux et européens, est confrontée à des défis liés à la croissance rapide des standards de consommation, dépassant les capacités d'une petite île fragile.
Les transitions démographiques, économiques et sociales sont interconnectées avec les changements nutritionnels, épidémiologiques et climatiques, entraînant des modifications dans les systèmes alimentaires.


Durabilité
À La Réunion, les enjeux en termes de durabilité s’adossent à des questions en matière de production locale, de circuits courts et de gestion des déchets alimentaires. Bien que des efforts soient déployés pour encourager l’agriculture locale et réduire la dépendance aux importations, les contraintes géographiques et économiques rendent ces objectifs difficiles à atteindre.
Par ailleurs, la gestion des déchets alimentaires reste un enjeu majeur, nécessitant une meilleure sensibilisation et des solutions innovantes pour minimiser l'impact environnemental.
DEUX ÎLES,
Maurice et Rodrigues
Maurice, historiquement tournée vers la monoculture de la canne à sucre, a progressivement diversifié son agriculture. L’abolition de l’esclavage en 1834 a marqué un tournant majeur : faute de main-d’œuvre servile, environ 500 000 travailleurs indiens ont été recrutés pour les plantations de canne à sucre pour remplacer les esclaves d’origine africaine. Par la suite, de nombreux immigrants notamment chinois sont venus ouvrir des commerces sur l’île. L’héritage multiculturel s’exprime également dans la cuisine locale, influencée par les traditions indiennes, africaines, chinoises et européennes.
Rodrigues, plus petite et plus isolée, conserve une tradition alimentaire axée sur les produits locaux. Elle est marquée par son histoire complexe, symbolisée par l’expression “Rodrigues noire/blanc”, qui reflète les tensions sociales et raciales entre les communautés locales, notamment les descendants d’esclaves et les descendants de colons européens. Bien que préservée dans ses traditions alimentaires et agricoles, et son environnement, Rodrigues connaît aujourd’hui des mutations dans son alimentation, notamment avec la présence plus forte de produits importés.
Le projet OR ALIM vise à analyser les situations de transition des régimes alimentaires dits “traditionnels” vers des régimes qualifiés de « occidentalisés » ou ‘globalisés”. Il cherche à identifier les dynamiques de changement nutritionnel afin d’élaborer des stratégies favorisant la santé publique tout en soutenant le développement socio-économique et le bien-être des populations mauriciennes et rodriguaises.
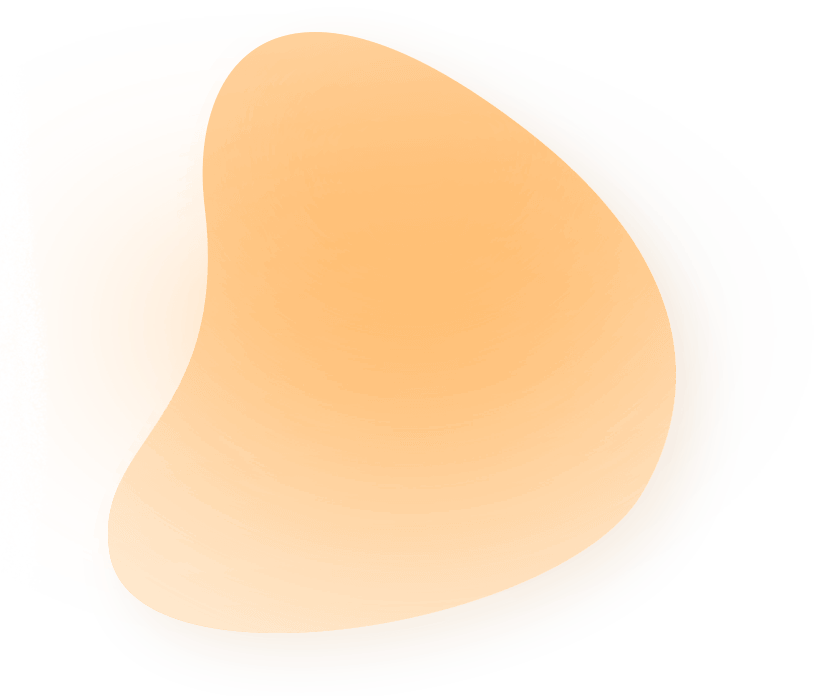
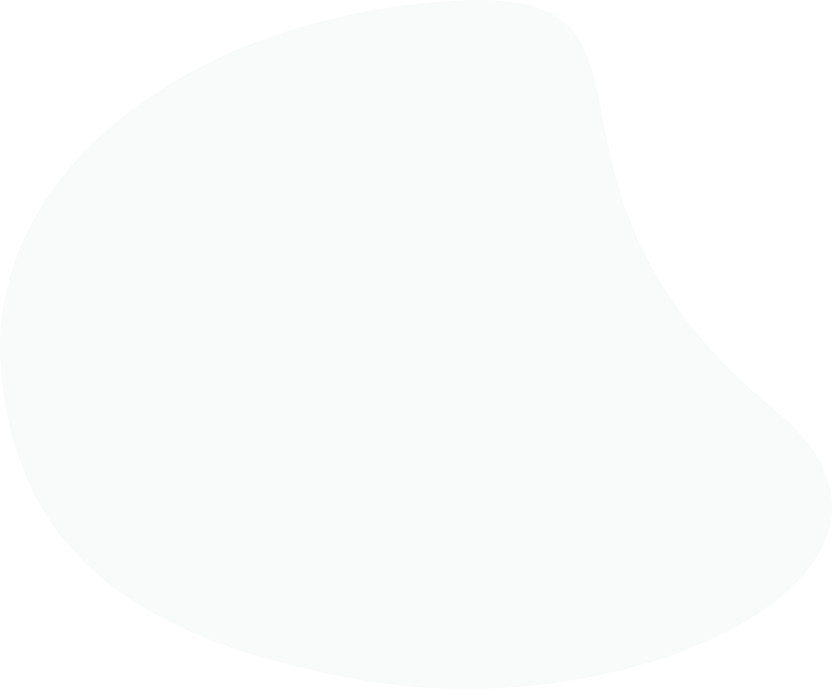
À Maurice, les plats emblématiques comme le biryani et le dholl puri coexistent avec une montée de l’alimentation transformée et rapide, conséquence de l’émancipation des femmes et de la transition vers des repas consommés à l’extérieur.
À Rodrigues, la cuisine se distingue par des plats simples et peu épicés, valorisant les produits locaux issus de l’agriculture vivrière (maïs, haricots, agrumes) et de la pêche artisanale, notamment les poissons séchés et fruits de mer.
La consommation de repas à l’extérieur, moins nutritifs, contribue à la hausse des maladies non transmissibles, qui représentent 85 % de la charge morbide à Maurice et Rodrigues.
L’hypertension est plus fréquente à Rodrigues, possiblement en raison d’une consommation élevée de sel. La prévalence du diabète de type 2, en hausse, a temporairement diminué en 2021 avec le retour aux repas faits maison pendant la pandémie de COVID-19
Maurice dépend fortement des importations pour ses produits de base, tandis que Rodrigues, plus autonome, s'appuie sur ses ressources locales.
Le développement de Rodrigues, amorcé après l’indépendance de Maurice, repose en grande partie sur l’exportation de ses productions vers l’île principale, constituant une source majeure de revenus pour les familles rodriguaises.
Maurice encourage une agriculture locale durable en réduisant l’usage des pesticides et en sensibilisant à une alimentation équilibrée.
Rodrigues, quant à elle, a su préserver son autonomie alimentaire en valorisant les circuits courts, offrant un modèle résilient et durable face aux importations croissantes.
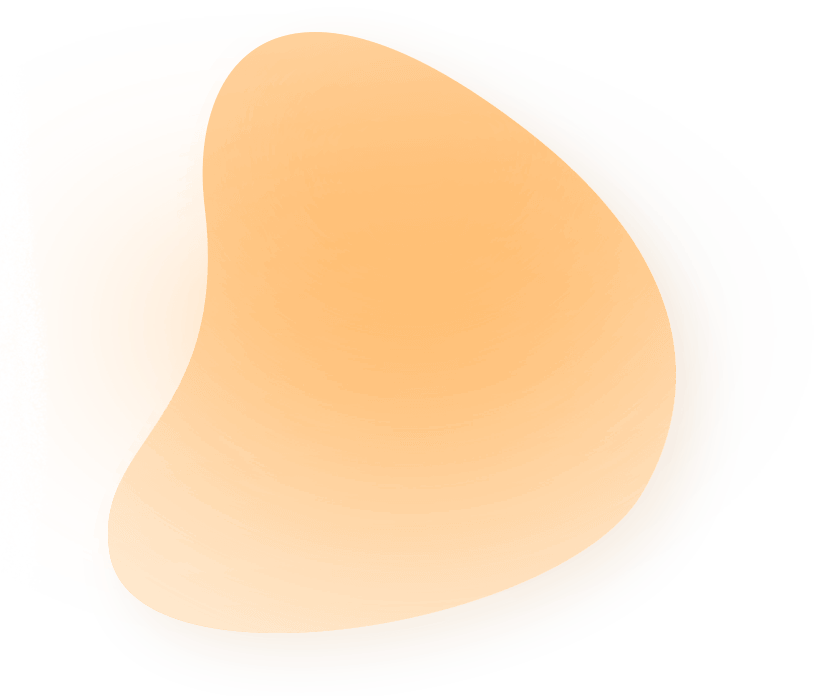
LA TRANSITION ALIMENTAIRE
À Mayotte
Mayotte, à la croisée des influences africaines (principalement bantoues et sahéliennes), malgaches, comoriennes et créoles, possède une identité alimentaire forte mais fait face à des défis spécifiques.
En effet, l’économie mahoraise est marquée par une croissance rapide soutenue par la forte démographie, ce qui accentue les défis en matière de sécurité alimentaire.
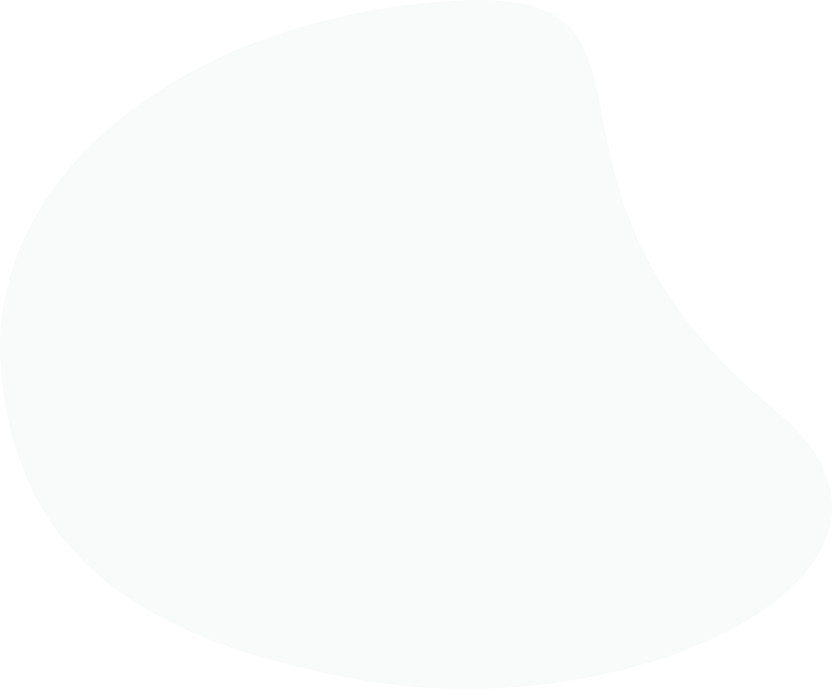
Les traditions culinaires de Mayotte mettent l'accent sur les produits locaux tels que le manioc, la banane verte et le poisson, ainsi que sur l'utilisation d'épices dans des recettes comme le mataba.
Dans les années 1980, l'alimentation mahoraise était centrée sur la noix de coco, le riz, la banane, le manioc et les légumes, avec une faible consommation de protéines, lipides et sucres rapides. Depuis les années 2000, on observe une augmentation de la consommation de riz, légumes et tubercules, de protéines animales, de produits transformés.
Les changements alimentaires à Mayotte posent des défis sanitaires, notamment l'augmentation des maladies métaboliques comme l’obésité et le diabète, ce qui souligne l’importance d’initiatives pour encourager une alimentation durable et équilibrée.
Aujourd’hui, la sous-nutrition, particulièrement chez les enfants et certains adultes, coexiste avec une transition nutritionnelle, marquée par l’augmentation de l’obésité, du diabète et de l’hypertension.
Mayotte est le territoire français avec le taux d’obésité le plus élevé (20,4%), et l’enquête Nutrimay révèle une surcharge pondérale de 45,7% et un taux de diabète de 10% en 2009.
Mayotte connaît une dépendance accrue aux produits importés, avec une montée des aliments transformés et un accès inégal à une alimentation équilibrée.
Cette dépendance rend l'île vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux, tandis que les évolutions des habitudes de consommation, influencées par la mondialisation, entraînent une transition alimentaire marquée par une hausse des produits transformés et une diminution de la part des produits locaux.
Mayotte voit l’émergence d’initiatives favorisant la souveraineté alimentaire et des pratiques durables.
Face aux défis sanitaires liés aux changements alimentaires, tels que l'augmentation des maladies métaboliques comme l’obésité et le diabète, ces initiatives soulignent l’importance de promouvoir une alimentation durable et équilibrée.





